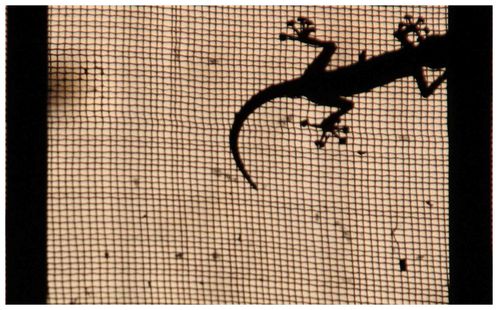L'homme ne sait jamais ce qu'il va devenir quand il entreprend de ne pas suivre un chemin tout tracé. Partir, c'est se retrouver dans une attente inquiétante, celle de la destination, de son terme et de sa physionomie ; c'est aller dans un espace où tout peut être remis en question, c'est prendre le risque de ne plus être comme tout le monde, d'être pris dans la solitude, de ne plus savoir qui on est et où on en est, de divaguer en quelque sorte.
Les jupes de maman (1/2)
par Jordy Grosborne
Vomir ! La liberté me donne envie de vomir ! C'est comme pour manger, si on a perdu l'habitude, ça porte sur l'estomac et l'indigestion est inévitable. Maman croyait le corps humain "intelligent". Pour éviter la satiété, il nous rend malade sitôt dépassé notre poignée de riz quotidienne. "Il est le garde-fou de notre réalité miséreuse", disait-elle à qui voulait l'entendre. Garde-fou, peut-être bien… Certainement pas garde-manger ! Mais un être humain ne se réduit pas à ses fonctions digestives… A jeun, mon estomac rapetisse. Prisonnier, mon esprit ne se restreint pas lui, il s'accroît plus encore, me fait sentir les effluves de nourritures inaccessibles et pourtant si proches, là haut, au cœur des rues touristiques. Dans ces dédales aux mille couleurs, les étals s'étendent, et la milice garantit que nous n'y toucherons pas quitte à tâter de la matraque et des bottes. Alors mon esprit s'échappe vers des contrées ou flâner n'est pas un vain rêve.
J'avais faim de liberté, de fruits et de viandes, de vie et ma ration quotidienne ne me contentait plus ! Voilà, entre autre chose, pourquoi je suis parti.
Oui, la liberté me fait vomir, et ce n'est pas de l'avoir trop savourée !
Je caresse un peu plus entre mes doigts engourdis le tissu des jupes sous lesquelles je m'enfouis depuis des jours dans cette cale sordide ! Moi qui fantasmais à propos des dessous - pans de coton multicolore, de lin, de dentelle - des filles, passantes aperçues depuis la cave où je travaillais, me voilà désormais tout entier enterré sous ces morceaux de rêves inexplorés. Le soupirail aux trop rares rais de lumières donnait sur une de ces fameuses rues touristiques. Au-dessus de nos vies, une boutique parmi tant d'autres. Notre " protecteur " y vendait aux étrangères des habits " De première qualité ! " Comme il le susurrait, confident d'un instant fugace, aux oreilles des femmes de passage venues se vêtir sur notre dos… Au sens propre comme au figuré. Nous, nous demeurions au niveau inférieur, le degré zéro de l'humanité, avec cette chaleur infernale faisant pleurer nos corps d'une transpiration acide et glisser nos doigts sous les aiguilles des machines à tricoter du souvenir pas cher. Des familles entières, de l'aïeul à l'à-peine-né, avaient l'estomac un peu plus rétréci chaque jour et l'esprit ivre de passer par-delà cette lucarne, inaccessible petit fragment de soleil. Parfois, nous regardions cette lumière et cherchions à y croiser le regard de dieu, juste pour comprendre. Certains d'entre nous avaient cessé d'y croire et travaillaient, sans relâche, mécaniquement, tentant d'ôter toute parcelle d'humanité de leur âme, car seule une bête peut accepter d'être traitée comme une bête. On peut mourir de faim, pas de devenir un animal.
C'est beau, une jupe, c'est doux. Toujours en mouvement, ça dévoile l'essentiel au gré des pas et du vent, et suscite des espoirs inavoués le long des jambes fines et bronzées. Aujourd'hui, plus que tout autre jour, elles sont un sanctuaire inespéré.
J'ai eu tant de chance de pouvoir m'y reposer, m'y cacher. Mon pauvre Liao, combien j'aurais aimé t'y laisser une place à mes cotés. En ton absence, j'ai désormais peur de m'y perdre !
Un sinistre craquement me surprend et je me recroqueville plus encore dans ce recoin où ma vie se cantonne depuis, peut-être, plusieurs semaines. J'ai perdu la notion du temps. La tempête se déchaîne au dehors et la coque du bateau ne cesse de se plaindre sous les assauts de l'océan. J'ai l'habitude de me blottir au pied des murs, la tête dans les bras, sous les coups redoublés de la police, du patron de la cave, des autres…Leurs bottes, leurs poings, étaient aussi inéluctables et réguliers que ces vagues faisant gémir le navire, et je gémissais, moi aussi. Mais je n'étais pas seul.
Liao, mon grand frère, mon refuge. Tu me hantes. Ils sont venus te chercher il y a maintenant une éternité, ne me laissant que ton absence. La force de quitter ce monde détestable, mais sans surprise, tu me l'as donnée. Le courage de m'enfuir, tu me l'as soufflé. L'envie d'aller voir tout en haut des jambes, tu me l'as offerte. Ta vitale présence, le sens de tout ceci, ils me l'ont volé.
On travaillait ensemble dans cette cave, avec nos parents, au début. Nous avions d'autres frères, mais pas de sœurs. Pas une fille qui puisse avoir le droit de vivre plus de quelques jours dans ce monde de rendement absolu. Notre mère n'avait pas le choix.
Nous nourrir, tous ! Voilà l'idée obsédante de notre père lorsqu'il a décidé, les mains jointes et les yeux humides, de nous abandonner pour trouver de l'argent en allant vers l'occident. Dans la petite pièce où nous dormions ensemble, nous entendions nos parents chuchoter. Des grands silences étaient régulièrement entrecoupés des sanglots maternels. Mais nous ne comprenions pas. Sauf toi, Liao. Toi, tu savais. Ce soir où les pleurs de notre mère furent plus intenses, ses larmes se frayant un chemin entre les crevasses des mains paternelles. Ce soir où tu t'es glissé jusqu'à eux, comme tout aîné l'aurait fait, pour partager leurs peines. Ce soir où tes yeux brillaient en te glissant à mes cotés.
Le lendemain matin, papa n'était plus là et notre mère semblait plus vieille de mille ans.
C'est ce matin là, Liao, que tu m'as expliqué les bateaux voguant vers l'occident, avec l'espoir de dizaines d'hommes comme seule marchandise… Et bien plus tard, j'ai appris les cimetières flottants, les corps dérivants, l'espoir agonisant et le corps de notre père porté par la houle.
Ils sont venus te chercher, mon frère, et c'est de ma faute…
Nous voulions partir nous aussi, mais notre mère s'y refusait, étreinte par la crainte que le monde meilleur ne soit pour ces enfants, constitué que d'eau salée de mer et de larmes. Maman, usée jusqu'à la trame des jupes tissées quinze heures par jour, ne peut plus nous prodiguer ses conseils aujourd'hui, mais elle nous a légué un tas de ballots de tissus multicolores.
Liao a donc échafaudé ce plan. La majeure partie de nos créations textiles partait vers l'Europe à bord de bateaux comme celui-ci pour y être vendues.
- Ces bateaux là ne coulent pas, m'avais-tu dis un soir, assis sur le ponton du port, le regard fixé sur le point où la mer tombe dans le giron de l'occident. Leurs marchandises sont bien trop précieuses, avais-tu terminé en souriant amèrement.
On avait embarqué clandestinement deux jours avant le départ, cachés entre les sacs de jupe, avec comme tout bagage un esprit démesuré et quelques provisions. Rien de grave, nos estomacs étaient depuis longtemps réduits comme peau de chagrin. Et si l'appétit revenait avec la liberté, il nous restait les vivres de l'équipage et les tonneaux d'eau douce étaient à portée de main.
L'angoisse et l'exaltation se disputèrent dès le début du voyage. Tu tentais d'ignorer les pas des marins martelant le pont au-dessus de nos têtes, d'ignorer que nos vies ne tenaient qu'à un fil. De la cave à cette cale, elles n'avaient jamais tenu à plus. J'aimais t'entendre chuchoter les souvenirs des parents, nos rêves d'enfants, nos jeux de rues… Chuchoter à mon oreille le monde de notre destination, maintes fois conté et si peu rencontré… Chuchoter des histoires où tu me laissais le plus beau rôle. J'étais l'aventurier, le soldat, le conquérant, l'explorateur et à chaque fois tu étais mon faire-valoir. Mon personnage préféré restait le flibustier des mers. Nous mimions des combats effrénés, silencieux, avec nos sabres invisibles et je portais fièrement le bandeau noir fabriqué par tes soins. Je l'ai, depuis ce jour maudit, enroulé autour de mon poignet et il m'accompagnera jusqu'à ma mort. Ce jour où, singeant avec force l'abordage de ton navire, j'ai glissé sur le sol humide, comme des milliers d'enfants dans les rues et cours d'écoles. Mais moi, j'étais à celle de la vie. Je me suis rattrapé tant bien que mal à une planche, une simple étagère pour des centaines de jupes. Elle n'a pas supporté ce poids supplémentaire et dans un vacarme assourdissant, elle s'est écrasée au sol, m'ensevelissant sous une montagne de tissus de toutes les couleurs, à moitié assommé.
Très vite, les cris ont martelés le silence, scandé par les bottes dévalant l'escalier qui menait à notre nouvel univers. La trappe ouverte à la volée te surprit, debout, sans que tu puisses esquisser un geste. Le jour aveuglant inonda la cale, manquant de me noyer autant que des litres d'eau salée l'auraient fait. J'ai compris après que tu n'avais pas cherché à te cacher, t'assurant simplement de ma sécurité, enfoui sous les jupes, et t'assurant surtout qu'ayant capturé leur clandestin, les marins n'en chercheraient pas d'autres. Tu as rompu ton fil pour prolonger le mien, mon frère. Pourrais-je seulement savoir à quoi il me relie désormais ?
à suivre…